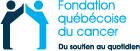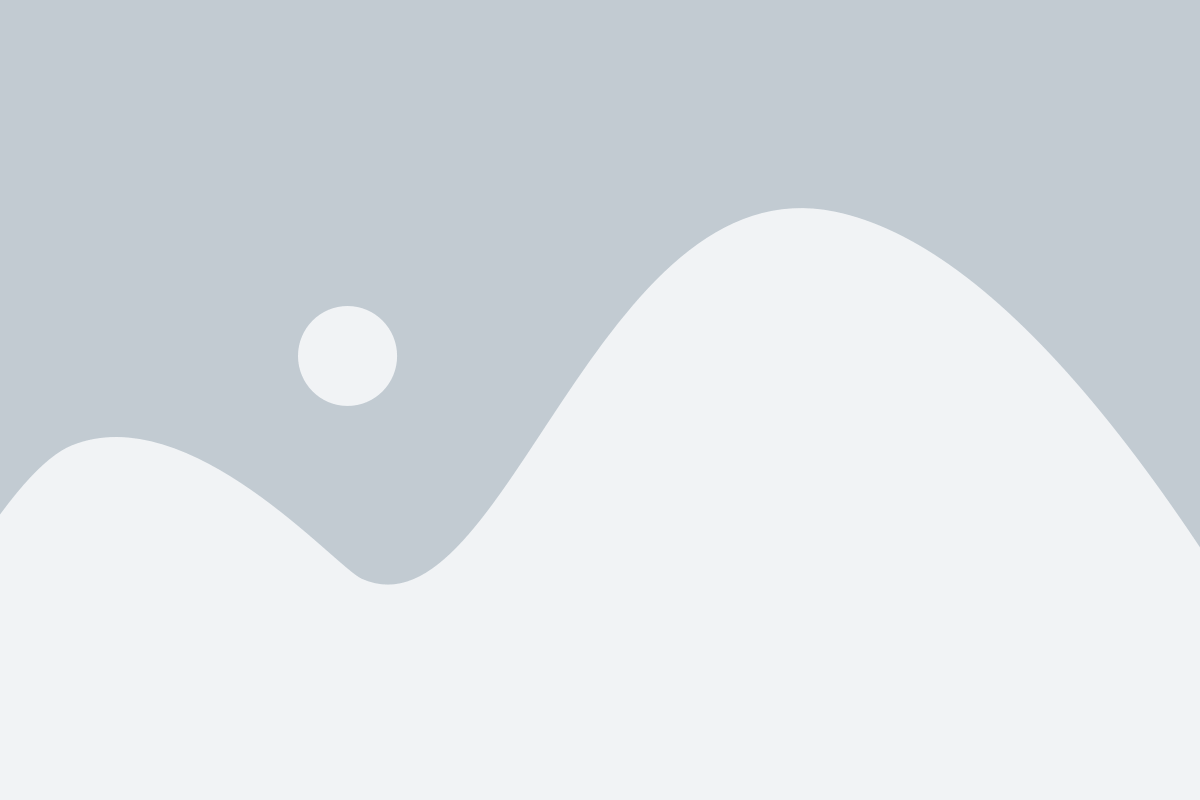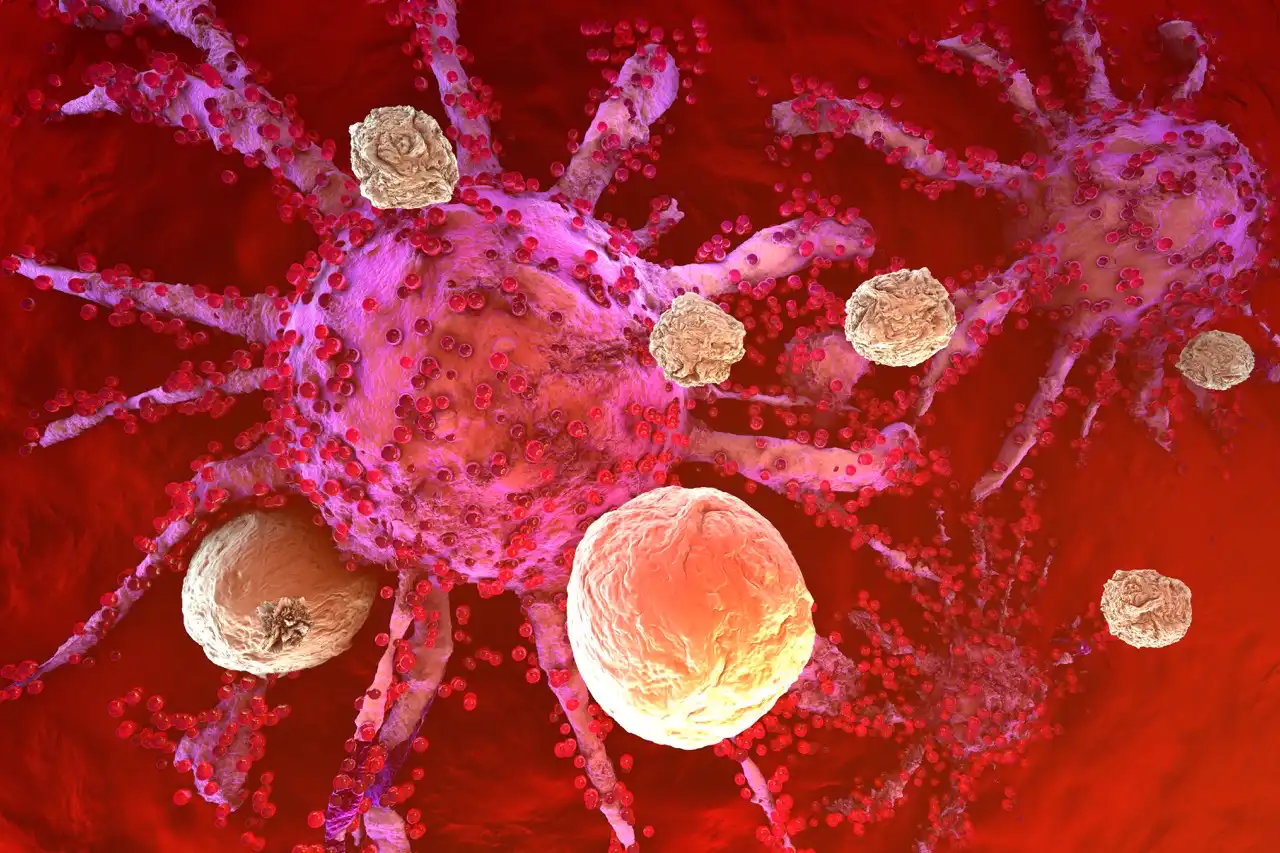Pour toute question :
Gérer les effets secondaires du cancer et des traitements
Dernière mise à jour : juin 2018
Généralement passagers, ils varient en fonction du traitement reçu et de la sensibilité particulière à chaque personne.Ils peuvent laisser croire à une aggravation de la maladie, mais il faut savoir que c’est rarement le cas. Cependant, il est important de connaître des façons efficaces pour gérer ces problèmes. Être au fait que ces effets secondaires sont courants et que l’on peut intervenir pour les atténuer permet d’apaiser les inquiétudes et de favoriser une meilleure qualité de vie pendant les traitements.

Les effets secondaires décrits ci-après sont les plus fréquemment observés en oncologie. Pour chacun d’entre eux, il y a une description pour aider à les reconnaître ainsi que des conseils utiles afin de gérer le mieux possible l’inconfort ressenti. De plus, étant donné que certains de ces effets – parfois intenses – demandent une attention professionnelle, il y a également de l’information indiquant à quel moment il faut les mentionner à l’équipe de traitement.
Empruntez gratuitement un ou plusieurs ouvrages sur le sujet en consultant notre répertoire ou consultez nos brochures d’information.
Anxiété et dépression
Certaines personnes ressentent des symptômes d’anxiété et de dépression pendant les traitements.
Constipation
La constipation se définit par une réduction de l’évacuation de selles formées dans l’intestin.
Diarrhée
La prise de bloqueurs hormonaux peut avoir des répercussions sur le fonctionnement des glandes endocrines et modifier légèrement l’apparence physique.
Effets secondaires associés à l’hormonothérapie (traitement anti-hormonal)
La fatigue est un sentiment de lassitude et d’épuisement, accompagné d’une sensation de faiblesse physique et d’un manque d’énergie.
Fatigue et anémie
La fatigue est un sentiment de lassitude et d’épuisement, accompagné d’une sensation de faiblesse physique et d’un manque d’énergie.
Hémorragies et saignements
Une baisse du nombre de plaquettes dans le sang (thrombopénie ou thrombocytopénie), associée aux traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, peut causer des saignements prolongés ou des hémorragies.
Inflammation de la bouche et de la gorge (stomatite/mucite)
Les muqueuses de la bouche et de la gorge sont des tissus très sensibles. Par le fait même, elles sont plus touchées par certains traitements.
Lymphœdème
Le lymphœdème est une enflure causée par l’accumulation anormale de fluides dans les tissus sous-cutanés.
Modifications de la peau
Les affections de la peau causées par la chimiothérapie se classent parmi les effets temporaires et occasionnels.
Modification du goût
Pendant qu’elles reçoivent des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, certaines personnes remarquent que leurs aliments ont un goût amer ou métallique.
Nausées et vomissements
Les nausées et les vomissements sont souvent temporaires et ne touchent pas toutes les personnes qui reçoivent des traitements contre le cancer.
Neuropathie périphérique
La neuropathie périphérique est le résultat des dommages aux neurones périphériques causés par les agents neurotoxiques de la chimiothérapie.
Neutropénie fébrile
La neutropénie fébrile est la complication la plus commune de la chimiothérapie.
Perte d’appétit
Dans la majorité des cas, les personnes atteintes d’un cancer et recevant de la chimiothérapie témoignent de troubles de l’appétit.
Perte de cheveux et de poils (alopécie)
La perte de cheveux et de poils est un effet secondaire fréquent de certaines chimiothérapies, qui débute généralement après deux ou trois semaines de traitements.
Réactions cutanées et des muqueuses
La chimiothérapie et la radiothérapie peuvent générer des réactions cutanées d’intensité variable, telles que des changements sur le plan de la couleur, de la texture ou de l’intégrité de la peau et des muqueuses (ex. : intérieur de la bouche, du nez, etc.).
Reproduction et fertilité
En règle générale, la chimiothérapie perturbe les fonctions reproductrices de l’homme et de la femme.
Sexualité
Les traitements contre le cancer perturbent de façon générale les activités sexuelles des personnes atteintes. Habituellement, il s’agit d’une situation temporaire. Cependant, la fertilité et la capacité de reproduction peuvent être compromises définitivement.
Symptômes urinaires
L’appareil urinaire comprend deux reins qui filtrent le sang pour en éliminer les déchets par l’urine. Cette dernière, formée dans les reins, traverse deux canaux (les uretères) pour ensuite rejoindre la vessie. L’urine demeurera dans la vessie entre les évacuations (les mictions), puis sera finalement éliminée par le canal de sortie (l’urètre).
Troubles digestifs autres que constipation et diarrhée
Les traitements médicaux, le manque d’exercice, la nervosité et les repas pris à la hâte peuvent aussi en être la cause.